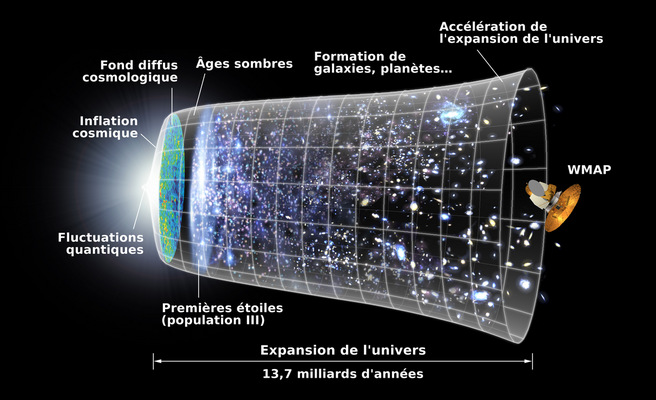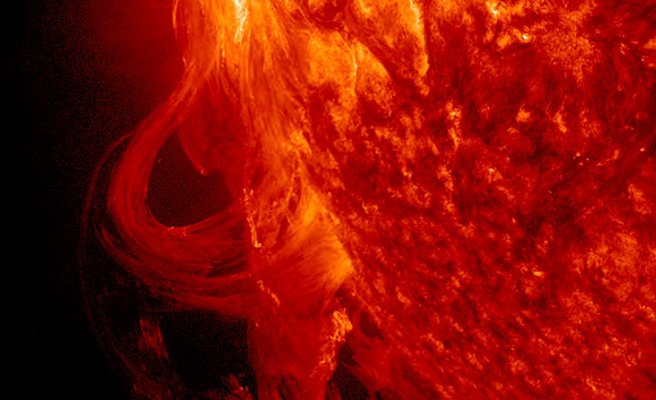Pourquoi faut‐il «nettoyer» l’espace?
Parce qu’il y a beaucoup de débris. Dans l’orbite basse, c’est à dire entre 200 et 2000 kilomètres d’altitude, leur nombre est de l’ordre de 20'000: ce sont des restes de lanceurs et étages de fusées, des satellites hors d’usage, des cellules solaires, des éclats de peinture et même du carburant solidifié par le froid interplanétaire. Tous ces débris constituent un danger parce que tout nouveau satellite peut entrer en collision avec eux.
Est‐ce qu’il fallait en tenir compte lors des missions spatiales que vous avez effectuées?
Ce n’est pas comme dans le film «Gravity» ou des nuages de débris détruisent tout sur leur passage. En réalité, la densité des débris est plutôt faible par rapport à l’immensité du volume que constitue l’espace. Tous les objets en métal de plus de 10 centimètres sont suivis au radar et on connait leur orbite. La Station Spatiale Internationale peut donc effectuer des manœuvres pour éviter des collisions. Même chose pour la Navette Spatiale dans le passé. Cela est arrivé à plusieurs reprises lors de mes missions. Mais contrairement aux engins spatiaux habités, l’orbite de beaucoup de satellites ne peut pas être modifiée. En 2009 un satellite russe inactif a détruit un satellite Iridium américain et a créé beaucoup de débris supplémentaires (voir aussi l'encadré * plus bas). S’ils sont suffisamment haut, ces débris en orbite peuvent avoir une durée de vie de plusieurs siècles.
L’homme dans l’espace – c’est une histoire relativement récente. Et déjà on a réussi à y créer un problème?
Il y a aujourd’hui plus de débris que de satellites actifs. Il s’agit donc de prendre des mesures. L’une c’est que désormais tout nouveau satellite doit avoir une durée de vie limite de 25 ans avant de redescendre et de rentrer dans l’atmosphère, soit par un propulseur, soit par une voile de freinage. L’autre piste qui est activement poursuivie par l’ESA (Agence spatiale européenne) et la NASA (Administration aéronautique et spatiale américaine), c’est d’aller enlever les gros débris. L’EPFL, qui travaille depuis cinq ans sur le projet CleanSpace One, a bon espoir de mettre en action un des premiers satellites démonstrateurs des technologies nécessaires pour y arriver.
Comment faut il s’imaginer la manœuvre de récupération?
L’idée c’est d’aller rechercher SwissCube, le petit satellite suisse conçu par l’EPFL et lancé en 2009 sur une orbite quasi polaire, de s’en rapprocher, de l’attraper et le désorbiter de façon contrôlée, grâce à un moteur ultra‐compact de CleanSpace One. Il faut s’imaginer ce dernier comme un grand panier qui s’ouvre et se referme au bon moment, puis quittera son orbite avec sa capture pour rentrer dans l’atmosphère. C’est donc une rentrée destructive, le tandem brûlerait en se transformant en étoile filante.
Et si ça marche, CleanSpace One pourrait devenir le prototype de toute une série de satellites nettoyeurs?
Oui, l’idée est de démontrer une technologie qui pourrait être utilisée par la suite pour construire des satellites nettoyeurs de plus grande taille et plus adaptés à la récupération systématique de grands débris. Et si cela ne marche pas, on aura quand‐même appris beaucoup de choses. «I never lose. I either win or learn», disait Nelson Mandela. C’est aussi une vérité pour l’aérospatial.
Pourquoi un petit pays comme la Suisse réussit à y jouer un rôle?
La Suisse est une nation spatiale. Nous sommes un petit pays, certes, et nos réalisations dans le domaine spatial ne sont pas à l’échelle de ce que font les Etats‐Unis, la France, l’Italie ou l’Allemagne. Mais la Suisse a réussi à occuper un grand nombre de niches dans le spatial. Pour une grande part cela repose sur l’expérience acquise dans la recherche horlogère: les montres, les mécanismes précis, les systèmes électroniques fiables, c’est notre point fort. Le Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM) à Neuchâtel par exemple est extrêmement avancé dans les systèmes de petites dimensions qui consomment très peu d’énergie et qui sont fiables. L’ESA reconnaît ces compétences suisses: on est rarement les leaders des projets de l'ESA, mais on contribue à beaucoup d’entre eux.
Vous êtes le premier et jusqu’à présent seul astronaute suisse. Que conseilleriez vous à un jeune qui rêverait de suivre vos pas?
Il faut comprendre qu’il y a beaucoup d'emplois pour des ingénieurs dans le spatial, que ce soit des ingénieurs mécaniciens, électriciens ou informaticiens, et un bon nombre d’entreprises qui sont actives dans le spatial en Suisse et qui ont besoin de tels ingénieurs: le CSEM ou Spectratime à Neuchâtel, la Ruag à Zürich ou Apco à Aigle, pour ne donner que quelques exemples. D’autres possibilités existent en Europe: beaucoup d’étudiants et assistants de l’EPFL vont faire des stages à l’ESTEC aux Pays‐Bas, centre principal de l’Agence spatiale européenne dédié à la conception et aux tests des engins spatiaux. Travailler dans l’aérospatial est donc tout à fait possible. Devenir astronaute c’est un peu plus compliqué, car il y a très peu de demande. Le corps des astronautes européens ne comprend que 16 personnes et il y a peu de place pour les petits pays. Mais je suis la preuve que c’est quand même possible. Pour y arriver, il faut mettre toutes les chances de son côté: étudier et travailler comme ingénieur dans le spatial, par exemple, ou comme chercheur, faire du sport, pratiquer une activité à risque comme l’aviation, la montagne ou la plongée sous marine – et puis s’inscrire et faire de son mieux lors de la prochaine sélection qui devrait avoir lieu au milieu des années 2020.